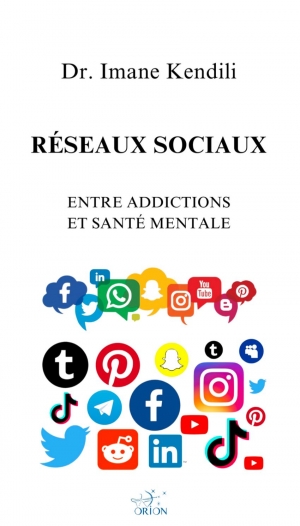Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....
LDA Journaliste
LDA–Inter/ Coopération : "La Côte d'Ivoire demeure un partenaire stratégique pour les Etats Unis" (Communiqué)
Abidjan, le vendredi 25 avril 2025 (LDA)-Les États-Unis réaffirment leur attachement à leur partenariat avec la Côte d’Ivoire, qualifiant Abidjan de "partenaire stratégique" dans un communiqué transmis ce vendredi 25 avril 2025 à La Diplomatique d’Abidjan (LDA) par l’ambassade américaine.
Cette déclaration intervient dans un contexte de coopération renforcée entre les deux pays, notamment à travers le programme Millennium Challenge Corporation (MCC), dont l’un des projets phares est la construction de l’échangeur du Grand Carrefour de Koumassi. Ce chantier d’envergure, entièrement financé par les États-Unis via le MCC, vise à améliorer la fluidité du trafic dans une zone névralgique de la capitale économique ivoirienne.
L’ambassade des États-Unis souligne que ce projet illustre concrètement la volonté de Washington de soutenir la croissance durable et inclusive en Côte d’Ivoire. Au-delà des infrastructures, la coopération bilatérale s’étend à d’autres secteurs clés tels que la bonne gouvernance, la formation, l’énergie et le commerce.
Le communiqué note également que les travaux de l’échangeur de Koumassi avancent de manière satisfaisante, traduisant le bon déroulement de la mise en œuvre du compact MCC signé entre les deux pays. Cet avancement est perçu par les États-Unis comme le reflet d’un engagement partagé en faveur du développement.
La Côte d’Ivoire et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques et économiques de longue date, fondées sur des intérêts communs en matière de stabilité, de prospérité et d’ouverture.
Armand Tanoh
Maroc : le Roi Mohammed VI lance les travaux de réalisation de la ligne à Grande vitesse Kénitra-Marrakech à Rabat
Abidjan, le vendredi 25 avril 2025(LDA)- Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les infrastructures ferroviaires se renforcent avec le lancement d’un programme structurant de 96 milliards de dirhams. Extension de la LGV jusqu’à Marrakech, modernisation de la flotte nationale, développement de réseaux de transport en commun au niveau de 3 agglomérations et émergence d’un écosystème industriel : une vision stratégique au service d’une mobilité durable, inclusive et compétitive, portée par une ambition continentale et tournée vers l’avenir.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a procédé, jeudi à la gare ferroviaire de Rabat-Agdal, au lancement des travaux de réalisation de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, d’une longueur d’environ 430 kilomètres.
Le projet de la LGV Kénitra-Marrakech traduit la Vision éclairée du Souverain en faveur de l’amélioration de l’offre ferroviaire nationale, et s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Royaume, sous l’impulsion de SM le Roi, en matière de développement durable, notamment la promotion de solutions de mobilité collectives à faible empreinte carbone.
Il illustre également la ferme détermination du Maroc à poursuivre le développement du réseau ferré national, afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle d’épine dorsale d’un système de transport durable et inclusif.
Ce projet structurant, d’une enveloppe de 53 milliards de dirhams (hors matériel roulant), fait partie d’un programme ambitieux mobilisant un investissement global de 96 MMDH qui porte également sur l’acquisition de 168 trains pour un montant de 29 Milliards DH, destinés au renouvellement du parc existant de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et l’accompagnement des projets de développement, ainsi que le maintien de la performance pour 14 Milliards DH, permettant notamment le développement de 3 réseaux de transport métropolitain au niveau des agglomérations de Casablanca, Rabat et Marrakech.
Le projet de la LGV Kénitra-Marrakech consiste en la création d’une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech, en desservant les aéroports de Rabat et Casablanca.
Avec ce nouveau projet, les temps de parcours seront de 1h entre Tanger et Rabat, 1h40 entre Tanger et Casablanca et de 2h40 entre Tanger et Marrakech (gain de temps de plus de 2h). Le projet permettra aussi de relier Rabat à l’Aéroport International Mohammed V de Casablanca en 35 minutes en desservant le nouveau stade de Benslimane. Il est prévu également un service à grande vitesse entre Fès et Marrakech avec un temps de parcours de 3h40 (avec des trains à grande vitesse circulant sur la ligne classique de Fès jusqu’au nord de Kénitra avant de continuer sur la nouvelle ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech).
Le projet de la LGV Kénitra-Marrakech porte notamment sur la conception et la réalisation d'une ligne nouvelle entre Kénitra-Marrakech conçue pour une vitesse de 350 Km/h, des aménagements des zones terminales de Rabat, Casablanca et Marrakech (Travaux sur voies exploitées), des équipements ferroviaires, la construction des nouvelles gares Grande Vitesse, des gares de train de proximité et l'aménagement des gares existantes, outre la construction du Centre de maintenance pour l'entretien des rames à Marrakech.
La réalisation de l’extension de la LGV Kénitra-Marrakech, permettra la libération de capacités sur le réseau classique qui en découle et ainsi le développement d’un important service de trains métropolitains de proximité (TMP) couvrant une partie des besoins en transport en commun pour les habitants des agglomérations de Rabat, Casablanca et Marrakech. Ce nouveau service de TMP constitue une véritable réponse aux enjeux de la mobilité urbaine au sein de ces trois aires métropolitaines et présente plusieurs atouts au niveau de la ponctualité, la qualité du service et la durabilité.
En concomitance avec le lancement du projet de réalisation de la nouvelle Ligne à Grande Vitesse Kénitra-Marrakech, l'ONCF lance un programme inédit d'acquisition de 168 nouveaux trains, visant à renforcer et rajeunir l'ensemble de la flotte matériel à voyageurs.
Mobilisant un investissement de 29 milliards de DH, ce programme d'acquisition permettra de réaliser les gains de performances opérationnelles, de renforcer les services régionaux, et de répondre à l'augmentation du trafic attendu à l'horizon 2030. Concrètement, cette acquisition porte sur 18 trains à grande vitesse pour les projets d'extension, 40 trains pour les services de lignes, 60 trains navettes rapides (TNR) et 50 pour le réseau de transport en commun au niveau des 3 agglomérations.
Cet ambitieux programme d'acquisition de matériel roulant permettra également l'émergence d'un écosystème ferroviaire industriel. Avec un taux d'intégration locale supérieur à 40 pc, le programme témoigne d'un fort engagement envers l’entreprise et les compétences marocaines et aura inéluctablement des implications positives en termes de soutien à l'économie nationale, de réduction des coûts de transport et de développement durable.
Le programme s’articule notamment sur deux principales composantes, la première est à caractère industriel et porte sur la mise en place et le démarrage d’une unité industrielle de fabrication de trains et développement d’un écosystème de fournisseurs et sous-traitants. La deuxième composante porte sur la création d’une joint-venture entre les constructeurs et l’ONCF pour assurer la maintenance courante et industrielle couvrant la durée de vie des trains avec une maîtrise des coûts.
S’étendant sur une durée de 10 ans, ce programme permettra la formation de ressources humaines spécialisées et la création de plusieurs milliers de postes d’emplois directs et indirects.
Avec le nouveau projet de modernisation, c’est tout le réseau ferroviaire marocain qui marque une réelle renaissance ne concernant pas uniquement l’extension du réseau grande vitesse jusqu’à Marrakech mais également la modernisation, le renforcement et le rajeunissement de la flotte de trains ONCF, ainsi que la création d’un réseau de transport en commun sur rails et d’un nouvel écosystème industriel porteur.
Cet important projet d’investissement et de modernisation du réseau ferroviaire a été mené en s’appuyant notamment sur l’expertise d’entreprises internationales de renom, dont le français Alstom pour le matériel roulant pour la Grande Vitesse, l’Espagnol CAF pour les trains inter-city (200 Km/h) ou encore le Sud-coréen Hyundai Rotem pour les trains métropolitains de proximité, avec des conditions de financement préférentielles.
Côte d’Ivoire : la Première Dame reçoit le premier vice-président International du Lions Club
Abidjan, le vendredi 2025(LDA)-Dans le cadre de sa visite officielle en Côte d’Ivoire, M. Singh, premier vice-président International du Lions Club, a été reçu en audience par la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, le mercredi 23 avril 2025, à ses bureaux de Cocody, selon un communiqué transmis à la rédaction ce jeudi 24 avril.
M. Singh était accompagné d’une délégation composée de Mme Sanguita Jatia, ancienne Directrice Internationale, Jean-Claude Crino, président du Conseil des Gouverneurs du Lions Club International, et Daniel Sampa, membre du cabinet du Président du Conseil.
« Nous sommes du Lions Club International c'est la plus grande organisation des clubs services au monde et nous sommes en visite en Côte d'Ivoire et dans le cadre de cette visite, nous avons tenu à rendre une visite de courtoisie à la Première Dame qui a eu la bienveillance de nous recevoir », a fait savoir Jean-Claude Crino, président du Conseil des Gouverneurs du Lions Club et porte-parole de la délégation.
Cette visite de courtoisie s’inscrit dans la continuité des actions humanitaires et sociales du Lions Club International, reconnu pour son engagement en faveur de l’entraide, de la solidarité et du développement humain. «(…) Nous sommes venus vraiment pour encourager nos clubs et nos membres à travailler en symbiose et dans le cadre des directives fixées par les autorités nationales et de voir que sur le terrain il y a déjà une très grande collaboration entre ce que fait la Première Dame dans le domaine social et la mission de service remplie par le club vis-à-vis des communautés et ça nous a fait énormément plaisir et nous encourageons le club a entrer beaucoup plus en relation avec La Première dame et les autorités nationales pour amplifier l'impact des services que nous rendons aux communautés », a déclaré M. Crino.
La Première Dame a exprimé sa gratitude envers M. Singh et sa délégation pour leur démarche, et a salué les efforts constants de l’organisation dans la promotion de causes sociales à fort impact, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et du soutien aux populations vulnérables. Elle a également formulé ses vœux de bienvenue et de succès à l’ensemble de la délégation pour le déroulement de leur mission en Côte d’Ivoire.
M. Singh sera à partir du 1er juillet 2025, le président international du Lions Club pour le monde entier. Cette organisation est forte de 1.400.000 membres. Elle est active dans 205 pays.
Dr Imane Kendili, une figure d’excellence au cœur du sommet africain du leadership à Kigali
Abidjan, le jeudi 24 avril 2025(LDA)- Dans un contexte marqué par des mutations économiques profondes et des enjeux de gouvernance majeurs, l’Afrique s’apprête à accueillir une rencontre d’exception : le sommet « 100 Africains les plus influents, Leadership et Business 2025 » du 4 au 6 juillet 2025, à Kigali( Rwanda).
La capitale rwandaise, deviendra le centre d’un dialogue de haut niveau qui va rassembler dirigeants, penseurs, décideurs et entrepreneurs venus de tout le continent.
Parmi les personnalités phares attendues à cet événement de prestige, Dr Imane Kendili, psychiatre de renommée internationale et voix influente du Maroc en matière de santé mentale, occupe une place toute particulière. Reconnue pour son engagement sans relâche dans les domaines de la santé publique, de l’entrepreneuriat féminin et du leadership éclairé, elle incarne une Afrique audacieuse, moderne et profondément humaine.
Forte d’un parcours exceptionnel alliant expertise médicale et engagement sociétal, Dr Kendili défend une approche globale du développement durable, où la santé mentale et le bien-être psychologique sont des piliers essentiels de la croissance économique et de la cohésion sociale.
Sa participation au sommet s’inscrit dans une volonté affirmée de replacer l’humain au centre des politiques de développement, dans une Afrique souvent confrontée à des défis de résilience et de stabilité.
Le sommet 2025, organisé par Africa Media Network en collaboration avec 100 Most Notable Peace Icons Africa et la Davdan Peace and Advocacy Foundation, mettra en lumière les parcours de figures emblématiques ayant un impact réel sur leurs communautés et au-delà.
La présence de Dr Kendili, aux côtés d’acteurs majeurs tels que Son Excellence Mallam Umar Namadi (Nigéria), le professeur Mthuli Ncube (Zimbabwe) ou encore le Dr Abdelhak Najib (Maroc), symbolise la reconnaissance croissante des acteurs de la santé et des sciences humaines dans les dynamiques de transformation du continent.
Au cours de ce sommet axé sur les « cadres de leadership pour la gouvernance, la croissance des entreprises, les opportunités d’investissement et le développement durable », Dr Kendili devrait porter un message fort : celui d’une Afrique qui mise sur le capital humain, l’innovation sociale et la santé globale pour construire un avenir viable et équitable.
Au-delà des distinctions honorifiques, dont celle des 100 femmes africaines les plus influentes à laquelle elle pourrait être nommée, sa participation sera l’occasion d’amplifier un plaidoyer essentiel : faire de la santé mentale un levier stratégique de développement, au même titre que l’agriculture, les infrastructures ou l’éducation.
Dans un espace longtemps dominé par les logiques économiques pures, elle s’impose comme une voix féminine influente et transversale, capable de relier les enjeux de gouvernance à ceux du bien-être collectif. Sa présence à Kigali incarne cette Afrique en pleine mutation, portée par des leaders sensibles, inclusifs et résolument tournés vers l’humain.
Côte d’Ivoire : le ministre Adjoumani présente les offres d’investissement dans le Secteur Agricole Ivoirien au 17e Salon International de l’Agriculture au Maroc
Abidjan, le mardi 22 avril 2025(LDA)-Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a conduit une délégation à la 17e édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM 2025) qui a ouvert ses portes, le lundi 21 avril 2025 à Meknès (Maroc), selon un communiqué consulté par la rédaction. Pour l’édition 2025, le thème retenu est : « Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable ».
Objectifs, présenter les offres d’investissement dans le secteur agricole de la Côte d’Ivoire, mais également s’inspirer des avancées majeures en matière de techniques, de technologies et de recherche enregistrées dans le domaine agricole marocain.
Le SIAM est également une occasion pour la délégation ivoirienne de renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et le Maroc dans le domaine agricole.
Devenu une plateforme d’échanges d’expériences du secteur agricole, le SIAM est une tribune de réflexion autour des problèmes qui minent l’agriculture au niveau mondial.
L’occasion est donnée aux experts du monde agricole de mettre en lumière l’importance de l’eau, pour l’équilibre des filières agricoles et la souveraineté alimentaire.
« Avec les changements climatiques, aujourd’hui, notre souhait est d’utiliser l’eau de façon raisonnable pour permettre à notre agriculture de se développer », a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani.
« Nous avons pris contact avec un certain nombre d’opérateurs économiques dans le cadre de notre Salon et l’occasion était aussi belle de pouvoir lancer des invitations à différents pays qui participent au SIAM 2025 afin qu’il y ait une ruée vers la Côte d’Ivoire à l’occasion de la 7ème édition du Salon international de l’Agriculture et des Ressources animales d’Abidjan (SARA 2025), a-t-il souligné.
Notons que le SIAM enregistre la participation de plus de 1 500 exposants et 70 pays. Le SIAM 2025 refermera ses portes le dimanche 27 avril prochain.
Côte d’Ivoire-Analyse/Échanges extérieurs : une diversification stratégique des partenaires commerciaux
Abidjan, le mardi 22 avril 2025 (La Diplomatique d’Abidjan)-L’analyse des données du commerce extérieur de la Côte d’Ivoire en 2024 révèle une architecture commerciale en recomposition, marquée par une diversification assumée de ses partenaires économiques. Tandis que la Chine et le Nigeria dominent du côté des importations, la Suisse et les Pays-Bas s'imposent comme des destinations clés des exportations ivoiriennes.
Un marché d’importation dominé par l’Asie et l’Afrique de l’Ouest
La Chine s’affirme une nouvelle fois comme le principal fournisseur de la Côte d’Ivoire, avec 2,735 milliards de dollars d’exportations vers Abidjan. Cette position confirme le poids croissant de Pékin dans l’économie ivoirienne, notamment dans les secteurs des infrastructures, des biens manufacturés et des équipements.
Fait notable, le Nigeria, pays voisin, arrive en deuxième position avec 2,311 milliards USD, une performance largement portée par les produits pétroliers raffinés, qui représentent une part substantielle des importations ivoiriennes. La proximité géographique et l’intégration sous-régionale jouent ici un rôle déterminant.
La France, longtemps premier partenaire commercial, conserve une place importante (1,113 milliard USD), mais voit sa part relative décliner. Les États-Unis (850 millions USD) et la Belgique (864 millions USD) complètent le quinté de tête, témoignant de la présence toujours active des économies occidentales dans le paysage économique ivoirien.
Des exportations orientées vers l’Europe et la sous-région
La Suisse se hisse au rang de premier client de la Côte d’Ivoire avec 2,751 milliards USD d’importations, principalement constituées de cacao et de produits dérivés. Ce chiffre illustre le rôle central de Genève comme hub mondial du négoce de matières premières.
Les Pays-Bas, via le port de Rotterdam, deuxième client du pays avec 2,504 milliards USD, renforcent leur position stratégique dans la redistribution des produits ivoiriens vers le marché européen.
Le Mali, troisième destination (1,669 milliard USD), illustre l’importance des échanges intrarégionaux, portés par l’UEMOA, notamment en matière de produits manufacturés, hydrocarbures et biens de consommation.
Les États-Unis (917 millions USD) et l’Allemagne (866 millions USD) figurent également parmi les cinq premiers clients, témoignant de la stabilité des liens transatlantiques, notamment pour les filières agricoles à forte valeur ajoutée.
Vers un rééquilibrage des relations commerciales ?
Ce tableau met en lumière une tendance à la multipolarisation des relations économiques extérieures de la Côte d’Ivoire. Le pays cherche visiblement à éviter une dépendance excessive vis-à-vis de quelques partenaires, tout en consolidant ses ancrages dans les chaînes de valeur mondiales et régionales.
Cette orientation s’inscrit dans une stratégie de résilience économique, dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et la nécessité de sécuriser ses approvisionnements comme ses débouchés.
Par La Rédaction de La Diplomatique d’Abidjan
(Toutes les données sont exprimées en millions de dollars américains, sources : douanes ivoiriennes, avril 2025)
Vatican : les principaux favoris pour succéder au Pape François. Comment se fera l'élection du nouveau Pontife ?
Abidjan, le mardi 22 avril 2025(LDA)-Le cardinal Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican sur sa chaîne Telegram a annoncé le décès du Pape François de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, à l'âge de 88 ans, le lundi 21 avril 2025, après plusieurs semaines où sa santé s'était dégradée. Le Vatican a indiqué que le Saint Père a succombé des suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC).
La mort du souverain pontife ouvre la période de vacance du siège apostolique, qui se terminera lorsque son successeur aura été élu. Cette élection qui devra se tenir 20 jours après le décès du Saint Père suit des étapes, et obéit à des règles bien précises.
Favoris à la succession
Plusieurs noms se dégagent, mais les plus favoris à la succession du Pape François sont :
• Pietro Parolin (Italie), numéro deux du Vatican, 70 ans. ...
Pietro Parolin, né le 17 janvier 1955 à Schiavon dans la province de Vicence en Vénétie, est un cardinal italien, secrétaire d'État du Saint-Siège depuis le 15 octobre 2013.
• Pierbattista Pizzaballa (Italie), patriarche latin de Jérusalem, 60 ans. ...
Pierbattista Pizzaballa, né le 21 avril 1965 à Cologno al Serio (Italie), est un archevêque catholique italien, patriarche latin de Jérusalem depuis 2024 .
• Matteo Maria Zuppi (Italie), archevêque de Bologne, 69 ans. ...
Matteo Maria Zuppi, né le 11 octobre 1955, est un cardinal italien, archevêque de Bologne depuis le 27 octobre 2015, et président de la Conférence épiscopale italienne depuis le 24 mai 2022.
• Claudio Gugerotti (Italie), 69 ans.
Claudio Gugerotti (né le 7 octobre 1955 à Vérone) est un prélat catholique italien et un diplomate au service du Saint-Siège. Le 21 novembre 2022, le pape François le nomme préfet de la Congrégation pour les Églises orientales.
Election du nouveau souverain pontife
L’élection du prochain souverain pontife répond à des règles bien précises.
Le conclave
Selon le chronogramme traditionnel dans l’élection d’un nouveau Pape, il y a le conclave. Et la constitution apostolique fixe le début du conclave entre le quinzième et le vingtième jour après la mort du pape. Il va réunir près de 135 cardinaux qui participeront au vote. Pour le premier jour du conclave, un seul scrutin est prévu. Il n'y a pas de campagne électorale publique ; les discussions restent confidentielles et empreintes de prière.
Pour être élu, un pape doit recueillir deux tiers des voix des cardinaux électeurs (moins de 80 ans). Si le premier vote n'aboutit pas, les trois jours qui suivent pourront compter jusqu'à deux scrutins par demi-journées. Si au bout de ces quatre jours, aucun nom ne s'est toujours détaché, les opérations de vote sont suspendues pendant une journée consacrée à la prière et aux échanges.
Le vote reprend le lendemain, pour une série de sept scrutins au maximum, répartis sur deux jours. Cette séquence peut être répétée deux fois. Un cardinal désigné conduit les méditations pendant ces journées de prière et de réflexion, souvent sous la coordination du Doyen. Si, au treizième jour du conclave (soit 34 scrutins), un pape n'a toujours pas été désigné, la constitution prévoit d'accélérer les choses.
Par deux aspects : la faculté d'élire le pape à la majorité absolue et celle de limiter le choix aux deux noms ayant reçu le plus grand nombre de voix lors du précédent scrutin. Ainsi, la durée du conclave n'excède généralement pas la quinzaine de jours.
La fumée blanche
Les yeux seront fixés sur la cheminée de la chapelle Sixtine, où seront brûlés les bulletins de vote des cardinaux. Si de la fumée noire en sort, cela veut dire que les cardinaux ne sont pas parvenus à élire un nouveau Pape. Par contre, si de la fumée blanche s'échappe de la cheminée, c'est le signe qu'un nouveau pape a été élu. L'élection est accompagnée par le son des cloches de la basilique Saint-Pierre, pour confirmer l'annonce d'un nouveau souverain pontife.
Funérailles
Les funérailles du Pape François ont lieu samedi. Dans l’histoire du Vatican, de nombreux papes ont été enterrés dans les grottes, dont Benoît XVI. Le pape François a souhaité être enterré dans un seul cercueil, fait de bois et de zinc, et reposera dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome.
CEDEAO: l'organisation célèbre ses 50 ans à Accra le 22 avril
Abidjan, le lundi 21 avril 2025(LDA)-Selon un communiqué de la CEDEAO relayé par APA le 16 avril dernier, la capitale ghanéenne, Accra, se parera aux couleurs de la Cédéao à l’occasion du lancement officiel des festivités marquant le cinquantenaire de l’organisation sous-régionale, le mardi 22 avril 2025.
Des ministres et hautes personnalités des États membres sont attendus pour cet événement symbolique, qui inaugurera une série de célébrations prévues dans toutes les capitales des pays membres de la Cédéao tout au long de cette année du cinquantenaire de l’organisation communautaire.
Le président ghanéen, John Dramani Mahama, donnera le coup d’envoi des activités commémoratives de ce 50e anniversaire.
La cérémonie d’Accra sera ponctuée de spectacles haut en couleur, avec notamment la révélation du logo et du thème du Jubilé d’or, ainsi que des prestations culturelles et artistiques retraçant l’histoire de la Cédéao : de sa fondation à Lagos par les Pères fondateurs, en passant par les grandes réformes, jusqu’aux succès et avancées significatives dans les pays membres.
La Conférence des chefs d’État et de gouvernement a fortement recommandé que cette célébration du cinquantenaire soit marquée par une grande visibilité dans chacun des États membres.
A cet effet, les membres du Comité administratif et financier de la Cédéao se sont réunis en visioconférence en février 2025 pour valider le programme des festivités à l’échelle régionale.
Fondée le 28 mai 1975 à Lagos (Nigéria), la Cédéao reste aujourd’hui la communauté économique régionale la plus structurée du continent, avec de nombreuses réalisations à son actif qui contribuent à l’intégration et au développement des populations ouest-africaines.
Le pape François est mort à l'âge de 88 ans( Vatican)
Un mois après sa sortie de l'hôpital pour une pneumonie infectieuse, le pape François est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé le Saint-Siège ce lundi 21 avril 2025.
Il est apparu en public pour la dernière fois dimanche, lors de la célébration de Pâques, place Saint-Pierre au Vatican, pour un bain de foule surprise.
Réseaux sociaux : reprendre le contrôle sur notre santé mentale
Abidjan, le lundi 20 avril 2025 (LDA)- Dans son tout dernier ouvrage intitulé : « Réseaux sociaux : Entre addictions et santé mentale », la psychiatre et addictologue Dr. Imane Kendili propose une analyse percutante de l’impact du numérique sur notre bien-être psychique et notre rapport au monde.
À travers une approche scientifique et accessible, elle explore les mécanismes neurobiologiques de l’addiction aux réseaux sociaux qui exploitent les circuits de la dopamine comme les drogues ou les jeux d’argent. Résultat : une dépendance insidieuse provoquant troubles du sommeil, anxiété sociale, fatigue mentale, perte de concentration, isolement et diminution des capacités cognitives.
Le livre met également en lumière l’essor massif de la désinformation sur les plateformes numériques. Les fake news circulent plus vite que la vérité, portées par des algorithmes qui privilégient le sensationnalisme et renforcent les biais cognitifs. L’illusion de libre arbitre est en réalité un piège algorithmique, orchestré pour capter l’attention et manipuler les émotions.
Autre dérive alarmante : la prolifération des faux experts. Dans cet espace numérique sans filtre, des individus non qualifiés prodiguent des conseils dangereux, notamment en santé mentale, au détriment de la rigueur scientifique. Cette confusion des rôles met en péril la santé de millions de personnes.
Dr. Kendili aborde aussi la violence psychologique du cyberharcèlement, particulièrement envers les femmes, et ses effets dévastateurs : dépression, perte d’estime de soi, stress post-traumatique.
Pour autant, l’ouvrage n’appelle pas à fuir les réseaux sociaux, mais à les utiliser de façon consciente. Elle plaide pour une éducation numérique, un esprit critique renforcé et des habitudes de connexion plus saines.
Ce livre essentiel appelle chacun à reprendre le contrôle sur son attention et sa santé mentale, dans un monde dominé par l’hyperconnexion.
La rédaction