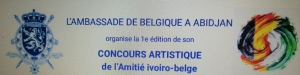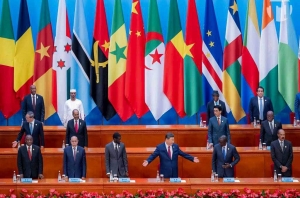Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....
LDA Journaliste
Amnesty International Côte d'Ivoire lance un Pool Presse pour renforcer la sensibilisation aux Droits Humains
Abidjan, 1 Mars- (LDA)- Lors de la première édition du « Grand Débriefing Amnesty et Médias », qui s’est tenue le mercredi 28 février 2025 à Abidjan, la chargée de communication d’Amnesty International Côte d’Ivoire, Sandra Kouakou a annoncé la création d’un Pool Presse.
Cette initiative a pour objectif de constituer un groupe dynamique chargé de faciliter la diffusion d’informations stratégiques sur les droits humains, tout en renforçant les liens avec les médias nationaux. Le but étant de favoriser une implication plus forte des médias dans la sensibilisation aux enjeux des droits humains et d’amplifier la voix des défenseurs des droits humains et d’assurer une couverture médiatique plus efficace des actions menées par l’organisation.
Sandra Kouakou a souligné l’importance des médias en tant qu’acteurs clés dans la sensibilisation et la mobilisation autour des droits humains. Elle a insisté sur le fait que « c’est ensemble que nous pouvons faire avancer cette cause », affirmant ainsi la nécessité de cette collaboration pour promouvoir les valeurs fondamentales des droits humains.
Le directeur exécutif d’Amnesty International Côte d’Ivoire, Hervé Delmas Kokou est revenu également sur l’importance de cette nouvelle collaboration.
Selon lui, l’accès à une information fiable et vérifiée est essentiel pour éclairer l’opinion publique et garantir une meilleure compréhension des enjeux liés aux droits humains.
Par ailleurs, Amnesty International Côte d'Ivoire envisage de renforcer l'éducation aux droits humains, d'intensifier ses campagnes d'action et de consolider sa collaboration avec les médias pour assurer une couverture plus large et plus engagée.
Dans cette optique, un Prix Amnesty International du Journalisme a été initié pour récompenser les reportages les plus marquants, afin de mettre en valeur le travail des journalistes qui participent activement à la sensibilisation et à l'éducation sur les droits humains.
Il convient de souligner que Amnesty International, une organisation de défense des droits humains fondée en 1961, est présente dans 150 pays et œuvre sans relâche pour promouvoir la justice et défendre les droits fondamentaux à l'échelle mondiale.
mc
Opportunités d'affaires : Business Initiative, une nouvelle passerelle économique entre la France et la Côte d’Ivoire
L’Ambassade de Côte d’Ivoire en France a réuni entrepreneurs et investisseurs lors d’une rencontre économique avec le réseau Business Initiative. L’objectif était de renforcer les échanges commerciaux et explorer de nouvelles opportunités d’investissement entre la France et la Côte d’Ivoire.
En marge du SIA 2025-Salon International de l’Agriculture de Paris, l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France a accueilli, le mardi 25 février 2025, une rencontre économique réunissant des hommes d’affaires venus de Marseille et de Aix en Provence autour d’un objectif commun : renforcer les liens économiques entre la Côte d’Ivoire et la France. Organisée par le réseau Business Initiative, cette soirée de rencontre a permis d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat entre les deux pays.
La Côte d’Ivoire, moteur économique de l’Afrique de l’Ouest, attire de plus en plus d’investisseurs grâce à sa croissance soutenue et à son climat des affaires en amélioration constante. Dans cette dynamique, la rencontre visait à connecter ses hommes d’affaires français avec la Côte d’Ivoire, afin de favoriser le développement de projets concrets.
SEM Anselme Angui, Premier Conseiller de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France, représentant l’Ambassadeur Maurice Kouakou Bandaman, a insisté sur l’importance de structurer et de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Il a notamment rappelé le rôle clé du Plan National de Développement 2026-2030, qui dessine les priorités stratégiques de notre pays pour les années à venir et les besoins en investissements dans plusieurs secteurs clés.
Pascal Lepelletier, représentant du réseau Business Initiative en l’Île-de-France, a souligné l’importance de la création de synergies entre les entreprises pour garantir un développement mutuel et durable.
Créée en 2014 à Aix-en-Provence, Business Initiative se distingue par une approche innovante des relations d’affaires. Selon Maitre Gérald Pandelon, co-fondateur, ce réseau s’appuie sur quatre principes fondamentaux : la diversité, en réunissant des hommes d’affaires , des hauts fonctionnaires, des avocats et des investisseurs; l’automaticité qui favorise les interactions directes et efficaces entre ses membres; la territorialité, qui encourage les échanges économiques entre différentes régions et pays et l’internationalisation, visant à élargir le champ des opportunités bien au-delà des frontières nationales.
Des opportunités à Saisir en Côte d’Ivoire qui avec une croissance économique de 6,5 % en 2023, se positionne comme un pôle d’attraction majeur pour les investisseurs internationaux. Plusieurs secteurs d’activité offrent des opportunités de développement, notamment l’agro-industrie, les ressources minières, l’énergie et les nouvelles technologies.
Dans ce cadre, Manuel Alves, homme d’affaires franco-portugais dans le minier et partenaire de Business Initiative, a mis en avant la nécessité pour la Côte d’Ivoire de diversifier ses partenariats internationaux. Il a également évoqué le rôle stratégique que pourrait jouer le Portugal dans le renforcement des échanges entre l’Afrique francophone et lusophone.
La soirée s’est poursuivie autour de rencontres BtoB où les participants ont pu échanger directement avec des représentants des secteurs économiques stratégiques éburnéennes à travers des rencontres B to B, où l’accent a été mis sur l’importance d’un cadre réglementaire structuré et attractif pour les investisseurs étrangers.
Les organisateurs ont réaffirmé leur volonté de faire de Business Initiative, un outil clé pour renforcer les relations économiques entre l’Europe et l’Afrique. Les discussions engagées devraient rapidement se traduire par des actions concrètes, ouvrant la voie à de nouveaux investissements et collaborations.
Avec cet événement, l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France confirme son rôle central dans la promotion des opportunités économiques ivoiriennes et l’accompagnement des hommes d’affaires souhaitant s’implanter sur ce marché en plein essor. Une dynamique prometteuse qui portera ses fruits les années à venir.
L’Ambassade de Belgique à Abidjan lance la 1ère édition de son concours artistique pour la Journée des Droits des Femmes 2025
À l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes et du « Mois des Femmes » en Côte d'Ivoire, l'Ambassade de Belgique à Abidjan organise la première édition de son concours artistique de l’Amitié ivoiro-belge.
Ce concours vise à valoriser les talents féminins en Côte d’Ivoire, en particulier dans la discipline de la peinture sur toile, toutes techniques confondues, sur le thème « Femmes en action ».
Le concours est ouvert à toutes les femmes artistes résidant en Côte d'Ivoire, qu'elles soient professionnelles ou amateures, âgées de 18 ans et plus. Chaque participante peut soumettre entre une et trois œuvres, sous forme de photos numériques, avant la date limite du 8 mars 2025 à 23h59. Ces œuvres seront ensuite soumises à une première sélection par un jury composé de personnalités ivoiriennes et belges.
Les œuvres sélectionnées seront publiées sur les réseaux sociaux de l'Ambassade afin de solliciter les votes du public. Celles qui obtiendront le plus de « likes » auront la possibilité de déposer leurs œuvres physiques à l'Ambassade de Belgique, en vue d'un vernissage fin mars 2025 à la Résidence de l’Ambassadeur de Belgique.
Lors de cet événement, le Jury attribuera le prestigieux Prix de l’Amitié ivoiro-belge à l’une des lauréates et un « prix du public » pourra être décerné à l’autrice de l’œuvre ayant récolté le plus de votes sur les réseaux sociaux de l’Ambassade.
Parallèlement au concours, une masterclass d’Enabel, l’agence belge de coopération sera offerte aux autrices des œuvres sélectionnées. Cette session permettra aux participantes d'en savoir plus sur les services de renforcement entrepreneurial et d’accélération disponibles dans le cadre du projet de mobilité circulaire (PEM) financé par l’Union Européenne.
Les œuvres sélectionnées seront ensuite exposées à l'Ambassade et la lauréate du Prix de l’Amitié ivoiro-belge aura l’opportunité de présenter une sélection plus large de ses œuvres lors d’un « solo show » à la Résidence de l’Ambassadeur. Cet événement sera l’occasion de réunir des personnalités du monde de l’art, de la diplomatie, des affaires, ainsi que des autorités et des médias.
Un concours artistique qui met en lumière la créativité féminine tout en renforçant les liens entre la Belgique et la Côte d'Ivoire.
mc
Le Fonds de développement de la CARICOM et Afreximbank signent un accord pour la mise en place d'une facilité verte pour la résilience et la durabilité
Abidjan, le 27 Février- Le Fonds de développement de la CARICOM (CDF) et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ont signé un accord de subvention de 708 000 € pour établir une facilité verte dédiée à la résilience et la durabilité (GRSF). Cette signature a eu lieu lors de la 48e réunion ordinaire de la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM au Wyndham Grand Barbados Sam Lord’s Castle.
La GRSF vise à offrir des financements mixtes, concessionnels et commerciaux afin de soutenir le développement économique de la CARICOM, en renforçant la résilience et l’adaptabilité des États membres face aux défis environnementaux et économiques.
Ce financement flexible permettra aux pays de la région d’investir dans des infrastructures critiques et des projets d’adaptation au changement climatique, contribuant à une croissance durable à long terme.
Le PDG du CDF, M. Rodinald Soomer, a souligné que cette subvention permettra au CDF d’apporter un soutien accru aux États membres confrontés à des enjeux environnementaux et économiques urgents.
Le Professeur Oramah, Président d’Afreximbank, a quant à lui précisé que le GRSF serait important pour mobiliser des investissements afin de faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique.
Il servira également à financer les pertes et les dommages liés au climat, réduisant ainsi le déficit de financement de la résilience estimé à 20 milliards de dollars US dans la région.
En août 2023, le CDF et Afreximbank ont renforcé leur partenariat avec un protocole d’accord, montrant un engagement mutuel à collaborer dans la mise en place de projets à long terme.
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale et internationale pour la durabilité et la résilience dans les Caraïbes.
mc
Cacao durable : des étudiants boursiers au service du plaidoyer des OSC auprès de l’Union européenne
Dans le cadre du projet ‘’Renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d’Ivoire’’, financé par l’Union européenne (UE), et visant à renforcer la participation de la société civile, des producteurs et des coopératives au dialogue politique sur le cacao durable, un mécanisme de bourses a été mis en place pour soutenir des étudiants chercheurs.
Ces travaux académiques, basés sur des recherches approfondies, serviront de fondement aux organisations de la société civile (OSC) pour mener un plaidoyer efficace auprès des décideurs européens en faveur d’un cacao traçable et respectueux des forêts.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte où l’UE impose désormais des normes strictes pour lutter contre la déforestation et réduire le changement climatique. Une nouvelle réglementation interdit l’importation de cacao provenant de plantations établies sur des forêts détruites après 2020. L’objectif est d’atténuer l’impact environnemental de la production de cacao en limitant la déforestation, principal facteur d’émissions de CO₂ et de perturbation des écosystèmes.
Plaidoyer des OSC
Les plaidoyers des OSC reposent sur des données concrètes et des études approfondies. Pour répondre à ce besoin, des appels à candidatures sont régulièrement lancés afin de recruter des experts et consultants chargés de produire des rapports d’étude. Cependant, une approche novatrice a été introduite dans le cadre de ce projet : mobiliser des étudiants en master et des enseignants-chercheurs pour mener ces recherches essentielles.
C’est ainsi qu’un programme de bourses a été mis en place pour financer les mémoires de master portant sur des thématiques stratégiques liées au cacao durable. Cette initiative permet non seulement d’apporter un soutien financier aux étudiants, mais aussi d’orienter leurs recherches vers des problématiques d’intérêt pour les ONG engagées dans le plaidoyer environnemental et socio-économique.
Partenaire clé
L’Université Lorougnon Guédé de Daloa, spécialisée dans les questions environnementales et la gestion des ressources naturelles, a été identifiée comme un partenaire clé pour la mise en œuvre de ce programme de bourses. Un accord a été signé avec un consortium d’OSC afin de réserver ces financements exclusivement aux étudiants de cette institution.
Un appel à candidatures est lancé chaque année, avec des critères de sélection rigoureux. Le processus est encadré par un comité composé de représentants d’OSC comme IDF, qui gère les bourses, ainsi que des enseignants-chercheurs de l’université. Pour la première phase du programme, six bourses d’un montant de 650 000 FCFA chacune ont été prévues. En 2024, deux étudiants ont été sélectionnés, et en 2025, quatre autres bénéficieront de ce soutien.
Les bénéficiaires de ces bourses
Les bénéficiaires de ces bourses sont issus de disciplines clés, notamment les sciences naturelles et le droit. Leurs travaux de recherche alimenteront les plaidoyers des OSC et contribueront à sensibiliser les acteurs du secteur sur les enjeux du cacao durable.
Parmi les étudiants sélectionnés, M. Diomandé, étudiant à l’Université de Daloa, a mené une étude sur l’impact du cacao sur les forêts rurales restantes. Son travail s’inscrit dans le cadre de la réglementation européenne, qui interdit l’importation de cacao provenant de plantations établies sur des forêts détruites après 2020.
Ses recherches visent à identifier les zones forestières situées hors des forêts classées et sacrées, pouvant potentiellement être utilisées pour la production de cacao sans enfreindre la réglementation. L’objectif pour les OSC est double :
• Utiliser ces données pour sensibiliser les producteurs sur les risques liés à la destruction de ces forêts, qui rendrait leur cacao inéligible au marché européen.
• Adresser des plaidoyers aux décideurs pour promouvoir la réhabilitation des terres en jachère et le renouvellement des anciennes plantations plutôt que la destruction de nouvelles zones forestières.
Ces travaux sont d’autant plus cruciaux que la réglementation européenne vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation, principal moteur du changement climatique. En protégeant les forêts existantes, cette initiative contribue à la captation du carbone et à la préservation de la biodiversité, garantissant ainsi une production de cacao plus respectueuse de l’environnement.
Recherche universitaire et les actions de plaidoyer
Ce programme de bourses illustre l’importance du lien entre la recherche universitaire et les actions de plaidoyer menées par la société civile. En connectant les étudiants et les ONG, ce projet permet d’apporter une expertise scientifique aux débats politiques et économiques sur la durabilité du cacao dans notre pays.
À travers ces initiatives, les OSC disposent désormais d’une base de données crédible pour dialoguer avec les décideurs européens et défendre les intérêts des producteurs ivoiriens tout en promouvant une culture du cacao respectueuse de l’environnement et alignée sur les efforts globaux de lutte contre le changement climatique.
Le Sénégal se prépare à accueillir les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en Afrique en 2026
Abidjan, lundi 24 février 2025/ -- Le Sénégal accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, premier événement sportif olympique organisé sur le sol africain. Dakar 2026 se déroulera sur deux semaines à partir du 31 octobre 2026 et réunira 2 700 des meilleurs jeunes athlètes du monde entier.
Ces JOJ, qui se tiendront sur trois sites (Dakar, Diamniadio et Saly), ont pour ambition de servir de catalyseur à la transformation du Sénégal par le sport, d'être porteurs d'un nouvel espoir pour la jeunesse africaine, de lui offrir de nouveaux débouchés et de lui donner confiance en elle, tout en devenant un modèle pour les futurs hôtes des JOJ.
Cette approche est incarnée par la devise des Jeux – "L'Afrique accueille, Dakar célèbre" – laquelle met en avant le caractère unique de cette édition des JOJ : le Sénégal est le premier pays africain à accueillir un événement sportif olympique, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) insiste sur le fait que les JOJ seront un événement pour l'ensemble du continent africain, la devise officielle de Dakar 2026 a été dévoilée lors de la 142e Session du CIO.
Avec sa devise, Dakar 2026 a montré sa volonté de créer une marque qui souligne sa vision unique des JOJ, laquelle entend proposer un événement qui associe la Téranga sénégalaise – la générosité d'esprit et l'hospitalité du pays hôte – au sport, à la jeunesse, à l'espoir et à la fête.
Trente-cinq Fédérations Internationales (FI) participeront à ces Jeux, 25 sports figurant au programme des compétitions et dix au programme de mobilisation. L'édition de Dakar 2026 présentera une discipline dans chacun des 25 sports au programme des compétitions : athlétisme, sports aquatiques (natation), tir à l'arc, badminton, baseball (baseball 5), basketball (3x3), boxe, breaking, cyclisme (cyclisme sur route), sports équestres (saut d'obstacles), escrime, football (futsal), gymnastique (artistique), handball (handball de plage), judo, aviron (aviron de mer), rugby (rugby à sept), voile, skateboard (street), tennis de table, taekwondo, triathlon, volleyball (volleyball de plage), lutte (lutte de plage) et wushu.
En outre, Dakar 2026 proposera un programme de mobilisation qui mettra en avant dix sports : canoë-kayak, golf, hockey, karaté, pentathlon moderne, tir, escalade, surf, tennis et haltérophilie. Ces sports ne figureront pas dans le programme des compétitions, mais leur promotion sera assurée par le biais d'activités interactives sur place et via des plateformes numériques, rappelant ainsi qu'ils font partie intégrante des JOJ.
Au total, les Jeux compteront 151 épreuves – réparties équitablement entre athlètes hommes et femmes avec 72 épreuves dans chaque catégorie, plus sept épreuves mixtes. Pour la première fois dans l'histoire des JOJ d'été, la parité femmes-hommes sera totale, non seulement en ce qui concerne le quota global d'athlètes, mais également dans tous les sports, toutes les disciplines et toutes les épreuves.
hn
Eglise catholique: le Pape François ne va pas bien (Vatican)
Dans un communiqué rendu public le samedi 22 février 2025(au soir), le Vatican annonce que l'état de santé du pape François reste «critique».
A 88 ans, souligne le Vatican, le Pape François a fait une "crise asthmatique respiratoire" et son "pronostic est actuellement réservé".
Initialement hospitalisé pour une bronchite, le Saint-Père a vu son état de santé se dégrader.
L'équipe médicale traitante n'est pas optimiste non plus. Elle indique que le pape n'est pas hors de danger. Déjà vendredi 21 février, l'équipe médicale avait précisé, lors d'une conférence de presse, a signifié que l'évolution de l'état de santé du pape n'est pas bonne. "Le pape est-il hors de danger ? Non, le pape n'est pas hors de danger", avait alors affirmé le Pr Sergio Alfieri lors d'un point de presse à l'hôpital romain Gemelli, où le pontife est soigné depuis son hospitalisation.
"Les analyses de sang effectuées aujourd'hui ont également révélé une platelopénie [troubles hématologiques, ndlr], associée à une anémie, qui a nécessité l'administration d'une transfusion sanguine. Le Saint-Père reste alerte et a passé la journée dans un fauteuil, bien qu'il souffre davantage qu'hier. Le pronostic est actuellement réservé", précise le communiqué.
Europe.fr
Chine-Taïwan : un risque d'escalade militaire qui menace la planète (Par Isidoros Karderinis)
Les relations entre la Chine et Taiwan sont constamment tendues depuis leur séparation de fait en 1949 et provoquent des tensions dans les relations entre Pékin et Washington.
Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame à Pékin la fondation de la République populaire de Chine. Les forces nationalistes du Kuomintang, parti chinois dirigé par Chiang Kai-shek, abandonnent la Chine et s'enfuient à Taïwan (anciennement Formose), puis forment un gouvernement le 7 décembre et interdisent toute relation entre l'île (officiellement la République de Chine) et la Chine communiste.
En 1950, Taïwan devient l'allié de Washington, qui est en guerre avec la Chine en Corée. En juin 1950, le président des États-Unis, Harry Truman, ordonne à la 7e flotte américaine de repousser toute attaque éventuelle des communistes chinois sur Taïwan. Dans le même temps, Chiang Kai-shek est chargé de construire des fortifications sur la côte de Taïwan pour empêcher une éventuelle attaque chinoise.
Le Parti démocrate progressiste (DPP) de Lai Ching-te, qui est au pouvoir pour la troisième fois, considère Taïwan comme une nation souveraine de facto avec une identité taïwanaise distincte et le mandarin comme langue officielle. Il convient de noter que Taïwan dispose de sa propre armée, de sa propre monnaie, de sa propre constitution et d'un gouvernement démocratiquement élu - de 1949 à 1987, il était sous un régime autoritaire de loi martiale - mais il n'est pas reconnu comme un pays indépendant par la plupart des gouvernements du monde.
À ce jour, il n’a été reconnu comme État indépendant que par 12 pays et n’a pas été accepté comme membre des organisations internationales, car la Chine insiste sur le fait que c'est sa province, faisant partie de son territoire, et empêche son intégration et sa reconnaissance.
Une puissance économique et un enjeu géopolitique mondial
Au fil des décennies, Taïwan est devenu de plus en plus isolé. Dans le même temps, les liens entre Taïwan et les États-Unis se sont renforcés, avec une augmentation des ventes d'armes et d'équipements militaires et une coopération politique de haut niveau sous la présidence de Tsai Ing-wen, la prédécesseure feminine de Lai, ce qui a suscité la colère de Pékin. Cependant, historiquement, la position des États-Unis à l'égard de Taïwan est restée délibérément vague, notamment sur la question de savoir s'ils défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise, la fameuse «ambiguïté stratégique».
Les États-Unis ont toujours marché sur une ligne rouge. Ainsi, dans le cadre de la politique dite d'«une seule Chine», Washington reconnaît la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légitime de la Chine. Il reconnaît également la position de Pékin selon laquelle Taïwan fait partie de la Chine, mais n'a jamais accepté la revendication de souveraineté du Parti communiste chinois sur l'île.
Taiwan a une superficie de 36.197 km² et une population d'environ 23.400.000 habitants. Sa capitale est Taipei, située à l'extrémité nord du pays. C'est une ville ultramoderne, dotée d'un développement industriel de haute technologie intense, officiellement désignée comme une «ville mondiale alpha», c'est-à-dire une ville qui a un impact direct sur les événements mondiaux de dimension sociale, économique et politique.
Outre l'île du même nom, le pays possède également 168 îles plus petites. Il est séparé de la Chine par le détroit de Taïwan et bordé au nord par la mer de Chine orientale, à l'est par l'océan Pacifique et au sud par la mer de Chine méridionale.
Depuis 1960, le pays est entré dans une période de croissance économique et d'industrialisation rapide, de nombreux économistes parlant du «miracle taïwanais». Son économie est tournée vers l'exportation. Elle excelle dans le domaine technologique et est actuellement la 21e économie mondiale, tout en se classant au 34e rang mondial en termes de PIB par habitant.
La position de Taïwan sur la carte du monde en fait un pays particulièrement important pour les grandes puissances mondiales. L'île revêt une importance stratégique majeure pour les États-Unis, compte tenu de sa proximité avec les alliés proches de Washington dans la région, tels que le Japon, la Corée du Sud et les Philippines. En outre, le détroit de Taïwan est considéré comme crucial pour le mouvement du commerce mondial, tandis que l'on estime que l'île produit 60 % de la production mondiale de puces électroniques, des composants technologiques essentiels à la fabrication de téléphones portables et de batteries au lithium.
La menace militaire et le risque d’escalade
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), dont le siège social se trouve dans l'immense parc scientifique de Hsinchu, est le plus grand producteur de semi-conducteurs (ou micropuces) au monde avec une capitalisation de 426 milliards de dollars.
Quant à l'équilibre militaire dans le détroit de Taiwan, il penche résolument en faveur de la Chine et il serait peu probable que l'État insulaire soit en mesure de se défendre en cas d'attaque chinoise sans aide extérieure.
Sous la présidence de Xi Jinping, la Chine a intensifié sa démonstration de puissance militaire, en envoyant un nombre record d’avions de chasse, de drones et de navires de guerre chinois autour de l’île et en organisant des exercices militaires en réponse aux échanges politiques entre les États-Unis et Taiwan.
Le message que Pékin a adressé à Taipei et à Washington à travers cette opération militaire est clair comme de l'eau de roche: «L'indépendance de Taiwan est incompatible avec la paix. Il s'agit d'une affaire intérieure qui ne permet aucune ingérence étrangère». Dans son discours du Nouvel An, le président Xi Jinping a d'ailleurs déclaré: «Personne ne peut empêcher la réunification de la Chine avec Taiwan», lançant ainsi un avertissement clair à toutes les forces qui soutiennent ouvertement l'indépendance à l'intérieur et à l'extérieur de l'île.
Taïwan, pour sa part, exige que la Chine mette définitivement fin à ses activités militaires dans les eaux voisines, qui, selon lui, compromettent clairement la paix et la stabilité et perturbent le transport maritime et le commerce international.
Mais quelles seraient les conséquences d’une guerre entre les USA-Taiwan et la Chine sur la planète? Un article de Bloomberg affirmait déjà qu’un conflit militaire à Taiwan pourrait coûter à l’économie mondiale la somme astronomique de 10 trilliards de dollars, soit 10% du PIB mondial, dépassant de loin les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, de la guerre en Ukraine et de la crise financière mondiale. Et bien sûr, le sang versé serait incommensurable.
En conclusion, je voudrais exprimer l’espoir que les choses ne empirent pas et que l’on évite ainsi une confrontation militaire entre les États-Unis-Taïwan et la Chine, qui serait désastreuse, comme cela a été souligné, non seulement pour la région mais aussi pour la planète entière.
-----
*Isidoros Karderinis est né à Athènes en 1967. Il est journaliste, correspondant de presse étrangère accrédité auprès du ministère grec des Affaires étrangères, ainsi qu'économiste, romancier et poète. Ses articles ont été publiés dans des journaux, des magazines et des sites Internet de nombreux pays du monde. Facebook : Karderinis Isidoros
Chine-Afrique : un exemple de partenariat entre pays du Sud
Abidjan, le jeudi 20 février 2025 - L'Afrique et la Chine renforcent leur collaboration pour la modernisation, un modèle de coopération Sud-Sud, selon des experts présents lors du 38e sommet de l'Union africaine.
Ces experts ont salué l'engagement ferme de la Chine envers l'indépendance et le développement durable du continent africain.
Selon Alexis Bih, expert en relations internationales, la Chine a intensifié ses investissements dans les infrastructures africaines et soutenu des projets de développement durable, contribuant ainsi à la croissance économique de l'Afrique.
Le Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), lancé en 2000 est devenu un mécanisme clé pour renforcer la coopération pratique entre les deux parties, comme l’a souligné Mathias Eric Owona Nguini, politologue.
Il a joué un rôle majeur dans le renforcement de la confiance mutuelle et a permis des progrès tangibles. Le sommet de Beijing 2024 a marqué un tournant dans la construction d'une "communauté de destin" entre la Chine et l'Afrique.
James Arrey Abangma, professeur à l’Université de Buea, a souligné l'importance des propositions chinoises pour promouvoir la modernisation et le développement durable en Afrique, notamment en soutenant la jeunesse et la formation de nouveaux talents.
Enfin, Cheikh Tidiane Ndiaye a insisté sur la nécessité d'un Sud global fort pour affirmer son influence face aux blocs occidentaux.
hn
Les grandes décisions du conseil des ministres
Un conseil des ministres a eu lieu le mercredi 12 février 2025 à Abidjan. Le président Alassane Ouattara a présidé ce conseil avec tous les ministres.