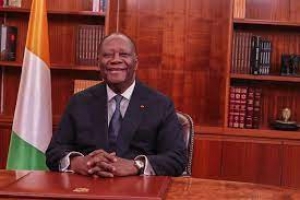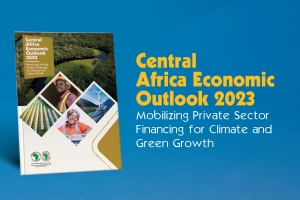Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....
LDA Journaliste
Côte d'Ivoire/ Enrôlement à la CMU : Le Ministre Adama Kamara s’assure du bon fonctionnement du site "IN SITU" du quartier Zone 4
Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara a visité le mercredi 9 août 2023, le site d’enrôlement "IN SITU" à la couverture maladie universelle (CMU) dans le quartier de Zone 4, dans la commune de Marcory.
Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale s’est félicité de l’ouverture de ce centre qui permet la production et la délivrance de la carte CMU en maximum 15mn après l’enrôlement. Il vient matérialiser un engagement pris vendredi dernier, lors de la conférence de presse du ministre Adama Kamara qui a annoncé l’ouverture de 900 nouveaux centres d’enrôlement dans les semaines à venir, sur l’ensemble du territoire national.
"Toutes les dispositions ont été prises pour ouvrir un grand centre en zone 4, un quartier à cheval sur les communes de Koumassi, Marcory et Port Bouët. Ce centre est ouvert 24h/24, et toutes les mesures d’hygiène et de sécurité ont été prises", a indiqué Adama Kamara.
Le ministre de la l’Emploi et de la Protection sociale a annoncé l’ouverture la semaine prochaine de trois autres centres "IN SITU", notamment à Yopougon, Tafiré et Ferkessedougou.
Selon la Directrice de l’Affiliation à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), Bamba Karidja, le centre de la Zone 4 enregistre une moyenne de 2000 enrôlés jour. Depuis son ouverture, la semaine dernière, c’est environ 8500 personnes qui y ont été enrôlées et qui ont reçu leur carte.
A en croire Bamba Karidja, ce sont 500 nouveaux sites d’enrôlement qui sont déjà ouverts sur les 900 annoncés vendredi dernier par le ministre Adama Kamara. Concernant les centres d’enrôlement "IN SITU", celui de zone 4 vient s’ajouter à ceux déjà existant de Bingerville, Adjamé,Cocody, Marcory et Daloa. Sont attendus pour la semaine prochaine, ceux de Yopougon, Tafiré et Ferkessedougou.
Le ministre Adama Kamara a encouragé les populations à aller se faire enrôler à la CMU, promettant que les dispositions sont prises pour davantage faciliter le processus.
OM
USA: Les 15 YALI ivoiriens de la cuvée 2023 reçus par l’Ambassadeur Ibrahima Touré
GÉRER LA CRISE AU NIGER : ET SI ON APPLIQUAIT UNE APPROCHE INSPIRÉE DE LA CRISE IVOIRIENNE
La crise diplomatique actuelle entre la junte nigérienne et la communauté internationale expose les ambitions des putschistes sahéliens, qui semblent chercher à profiter de l'effet déstabilisant du fait accompli. Cette stratégie a réussi à faire paraître les militaires de Niamey comme des défenseurs d'une nation souveraine, confrontée à des va-t-en-guerre de la CEDEAO et de la communauté internationale.
Au cœur de cette confusion, l'inertie et le manque d'initiative du gouvernement légitime du Niger demeurent incompréhensibles. À ce stade, il serait judicieux de puiser des leçons de la crise ivoirienne, une source d'inspiration pour la communauté internationale et en particulier pour les autorités nigériennes.
La démarche à suivre est relativement simple. Le gouvernement nigérien doit entreprendre des actions de gouvernance, d'autant plus que le Premier Ministre du Président Bazoum est hors du Niger et libre de ses mouvements. Dans des circonstances similaires, Alassane Ouattara, Président élu de Côte d'Ivoire, tout en restant sur le territoire ivoirien, avait opéré depuis le fameux "Hôtel du Golf", prenant des mesures audacieuses qui ont finalement ébranlé l'usurpation de la présidence par Laurent Gbagbo.
Par conséquent, les autorités légitimes du Niger, ou ce qui en reste en liberté, doivent sortir de leur léthargie et adopter cette méthode ivoirienne. Cette approche pourrait inclure des actions simples, que nous esquissons ici :
- Exploiter la reconnaissance internationale dont le Niger bénéficie pour solliciter l'ensemble des ambassades nigériennes à l'étranger, les invitant à entreprendre des initiatives diplomatiques actives.
- Nommer et révoquer, si nécessaire, des ambassadeurs ou des fonctionnaires nigériens en poste à l'étranger, ne serait-ce que pour démontrer la présence d'un pouvoir légal.
- Identifier les mécanismes juridiques pour révoquer tous les militaires impliqués dans la tentative de coup d'État et symboliquement dissoudre les entités complices des putschistes.
- Éventuellement, désigner l'ambassadeur du Niger en France en tant que Ministre des Affaires Étrangères et le charger d'une offensive diplomatique.
- Participer en tant que gouvernement légitime du Niger à toutes les réunions internationales, en particulier celles de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU.
- Former un gouvernement de crise basé dans une ambassade d'un pays ouest-africain, qui se réunit régulièrement et publie des communiqués officiels.
- Établir des organes de communication en ligne (télévision, radio, presse écrite) pour diffuser largement les déclarations du gouvernement légitime.
- Émettre un décret pour nommer de nouveaux responsables militaires et symboliquement assigner l'armée à une mission visant à reconquérir les symboles du pouvoir, ce qui pourrait faciliter une intervention discrète des forces internationales.
Ces mesures, combinées aux sanctions de la communauté internationale, pourraient rapidement engendrer des résultats positifs aux abords du Niger.
Farga Boulo (Membre du groupe des vétérans du renseignement)
Côte d'Ivoire/ 63e Anniversaire de L’indépendance : Le Président Alassane Ouattara rassure quant à la redistribution des fruits de la croissance économique
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a rassuré ses concitoyens de la redistribution des fruits de la croissance. Il a fait cette annonce dans le cadre de son message à la Nation à la veille du 63e anniversaire de l’indépendance, le 06 août 2023 à Abidjan.
« La mise en œuvre de nombreux projets et programmes, en particulier, le Programme social du gouvernement (le PS-Gouv), initié par feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, ont permis de renforcer l’offre et la qualité de service dans ces secteurs prioritaires sur toute l’étendue du territoire national. Conformément à nos engagements, nous avons redistribué les fruits de la croissance », a indiqué Alassane Ouattara.
Pour le Président de la République, la redistribution des fruits de la croissance se traduit par des mesures sociales fortes telles que la revalorisation du SMIG, l’augmentation de la rémunération des fonctionnaires, ainsi que des fonds alloués à l’entrepreneuriat et aux initiatives des jeunes.
Le Chef de l’État a fait savoir que le programme Jeunesse du gouvernement (Pj-Gouv) est une nouvelle approche dans la prise en charge des besoins de nos jeunes dans leur diversité, en mettant l’accent sur la formation, l’encadrement, l’insertion professionnelle et le développement des compétences. Ce programme est doté d’une enveloppe globale de 1 118 milliards de F CFA pour la période 2023-2025.
KM
Situation au Niger : Les décisions de la CEDEAO sont celles de tous les pays membres
Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement, Monsieur Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI, et le Ministre des Affaires Étrangères du Bénin, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, ont animé une conférence de presse conjointe le vendredi 04 août 2023 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour dont ceux relatifs aux décisions de la CEDEAO sur la prise d'otage qui a eu lieu au Niger. Cette prise de parole a surtout permis de clarifier la position du Bénin dans cette crise.
Des professionnels des médias venus de plusieurs pays africains ont pris part à ladite conférence de presse avec à la clé des questions diverses et variées auxquelles les deux conférenciers ont apporté des réponses adéquates.
L'Afrique de l'Ouest est secouée ces dernières années par des coups d’État intempestifs qui mettent à mal l'ordre constitutionnel dans les pays concernés. Face à l'instabilité que ce malheureux fléau engendre pour les pays de l'espace sous-régional et pour l'Afrique en général, la Conférence des Chefs d’État des pays membres de la CEDEAO a décidé de prendre le taureau par les cornes afin de siffler la fin de la pagaille. De leur réunion à Abuja au Nigéria, plusieurs pistes de sortie ont été proposées aux militaires qui ont renversé le président démocratiquement élu du Niger mais également plusieurs sanctions fortes à l'encontre du Niger. Ce qui a le plus retenu l'attention des professionnels des médias, c'est l'option militaire qu'envisage la CEDEAO en cas d'échec des négociations engagées avec les putschistes nigériens.
Des propos des conférenciers, il ressort que la démarche pacifique de la CEDEAO, c'est pour préserver les États et surtout pour la sécurité des élus : « N'importe qui, avec une kalachnikov peut décider de prendre le pouvoir du jour au lendemain. Ce n'est pas bien. Cette instabilité n'est pas une instabilité productrice, génératrice de développement », a indiqué Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, Ministre des Affaires Étrangères du Bénin.
Et pour le Porte-parole du Gouvernement du Bénin, Monsieur Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI, chaque acteur sociopolitique doit savoir rester dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité. « La responsabilité des élus, c'est d'administrer des États, c'est d'appliquer des programmes de gouvernance qui améliorent les conditions des populations. La responsabilité des militaires, c'est de défendre l'intégrité du territoire national, c'est d'assurer la sécurité des pays. Les militaires eux-mêmes savent que la solution n'est pas dans les coups d’État ».
Il ne s'agit pas simplement d'un coup d'État mais pire d'une prise d'otage. Cela est inadmissible aux dires des conférenciers.
« La position de la CEDEAO à laquelle souscrit le Bénin est très claire. Le Président Mohamed BAZOUM est le Président démocratiquement élu du Niger et est le seul que nous reconnaissons. Tout ce que la CEDEAO demande, c'est la réinstallation du Président BAZOUM dans sa fonction de Président de la République. Il ne s'agit pas d'exfiltration mais il s'agit de réinstallation », indiquent-ils.
La CEDEAO privilégie le dialogue. L'option militaire reste la toute dernière en cas d'échec pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, fait remarquer le Porte-parole du Gouvernement. Et face à l'intoxication que propagent certaines personnes en faisant croire aux populations que le bonheur de nos États africains dépend des autres, Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI lance un appel : « Je veux que nous aidions nos populations africaines à comprendre que c'est quand même dangereux qu'au 21ème siècle, les Africains soient les seuls sur la terre à penser que c'est telle ou telle puissance qui agirait pour les rendre heureux ou non. Les populations africaines doivent comprendre que si les autres sont au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils ont travaillé pour. Le seul chemin pour nous aussi, c'est de faire les mêmes efforts pour y arriver et non de penser que notre bonheur dépend de tel ou tel pays. Ce n'est pas vrai du tout ».
Il ne s'agit pas dans le contexte actuel d'un avis personnel de la part d'un État mais plutôt de l'intérêt de tous les États membres de la CEDEAO. Raison pour laquelle, les conférenciers ont indiqué que les décisions de la CEDEAO sont celles du Bénin et tout comme les autres pays, le Bénin mettra en œuvre toutes les décisions issues de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO.
Et pour celles et ceux qui pensent que ces décisions de la CEDEAO sont dictées par des puissances étrangères, le Ministre des Affaires Etrangères a été clair : « La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des pays membres de la CEDEAO est une conférence souveraine. Les Chefs d'État se sont retrouvés à huis clos. Ils ont pris des décisions à huis clos sans aucune intervention extérieure ».
Sur l'engagement du Bénin en cas d'option militaire, le Porte-parole du Gouvernement espère que les militaires, auteurs de la prise d'otage entendront raison et accepteront la main tendue de la CEDEAO. Mais Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI a rassuré qu'en cas d'intervention militaire qui serait décidée par la CEDEAO, le Bénin montrera son engagement en temps opportun.
En cas de mouvement de population nigérienne vers le Bénin, les conférenciers ont rassuré que le Gouvernement du Bénin prendra toutes ses responsabilités.
ng
L’Inde, nouveau partenaire de la Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique
Le gouvernement indien contribuera à hauteur de 2 millions de dollars à la Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI), hébergée et gérée par la Banque africaine de développement , affirmant ainsi son engagement à aider à lever les obstacles à la croissance et à l’adoption de solutions financières numériques et à accélérer l’inclusion financière en Afrique.
Reconnue mondialement pour le succès de son système de paiements publics numériques qui a transformé la gouvernance, l’inclusion financière et la résilience pour des millions de personnes à travers le pays, l’Inde, par sa collaboration avec l’ADFI, permet à la facilité de tirer des enseignements des meilleures pratiques et d’aider à amplifier les initiatives pour répondre aux besoins des personnes financièrement exclues et défavorisées en Afrique.
Bien qu’il soit de plus en plus évident que la numérisation catalyse le développement durable en Afrique, des données récentes montrent que près de la moitié de la population adulte du continent ne bénéficie pas de solutions financières numériques, en particulier les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les petites entreprises et les communautés rurales
Manisha Sinha, secrétaire adjointe au Département des affaires économiques et membre principal du Conseil d’administration de l’ADFI pour l’Inde, a déclaré que le modèle unique, abordable, inclusif et équitable de l’infrastructure publique numérique de l’Inde offre des possibilités d’apprentissage partagé dans l’ensemble de l’écosystème de la finance numérique.
« Le rôle pionnier de l’Inde dans les services financiers numériques, l’extension de l’inclusion financière aux zones rurales reculées et la création d’infrastructures pour la numérisation des services financiers, offre à l’Inde une excellente opportunité d’œuvrer au sein du partenariat de l’ADFI pour partager l’apprentissage et l’expertise sur l’infrastructure publique numérique afin de promouvoir l’inclusion financière numérique à travers le continent », a ajouté Mme Sinha.
L’ADFI soutient la stratégie décennale de la Banque africaine de développement axée sur la croissance inclusive et la priorité « High 5 » qui vise à Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Son rôle s’aligne également sur le mandat du Département du développement du secteur financier de la Banque, qui est d’améliorer l’accès au financement pour les populations défavorisées. L’ADFI s’emploie à transposer à plus grande échelle des solutions financières numériques innovantes dans le cadre des trois grands piliers stratégiques que sont l’infrastructure, les politiques et réglementations ainsi que les produits innovants. Le renforcement des capacités et l’inclusion de la dimension genre sont transversaux à toutes les interventions.
Solomon Quaynor, vice-président chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’industrialisation de la Banque africaine de développement, a déclaré : « Nous sommes heureux que le gouvernement indien soutienne le rôle de catalyseur joué par l’ADFI dans l’accélération de l’accès et de l’utilisation des solutions financières numériques et de l’inclusion financière sur l’ensemble du continent. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler ensemble pour intégrer les enseignements tirés de l’expérience réussie de l’Inde en matière d’infrastructure publique numérique dans notre portefeuille croissant d’initiatives de solutions financières numériques afin d’accroître l’impact sur l’autonomisation économique, la résilience et la croissance en Afrique. »
hn
Côte d'Ivoire: Le Président Alassane Ouattara appelle a des élections régionales, municipales et sénatoriales apaisées
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité que les élections régionales, municipales et sénatoriales se déroulent dans un climat de paix et de fraternité, gage de consolidation des acquis démocratiques de la Côte d’Ivoire. C’était dans le cadre de son discours à la nation, le 06 août 2023.
Le Chef de l’État a indiqué que les Ivoiriens seront appelés aux urnes, le 02 septembre prochain, pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Quant aux élections sénatoriales, elles sont prévues pour le 16 septembre 2023.
Alassane Ouattara en a appelé au sens de responsabilité de tous les candidats des partis politiques et de l’ensemble des concitoyens.
Pour le Président de la République, la paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent nos atouts les plus importants pour la stabilité de notre pays. « Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays », a-t-il conclu.
km
Madagascar- Rwanda : Un renforcement des relations politiques et économiques entre les deux nations
Le Président de la République de Madagascar, Son Excellence Andry Rajoelina, entamera une visite officielle de deux jours au Rwanda les 7 et 8 août. Cette visite symbolise le fort lien entre lui et le Président Paul Kagamé, une relation qui sert à intensifier la coopération et la collaboration entre Madagascar et le Rwanda.
Il sera accompagné par quatre membres du gouvernement, le Ministre des Mines et des Ressources stratégiques, le Ministre de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement, le Ministre du Développement numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications, le Secrétaire d’État en charge des Nouvelles villes et de l’Habitat et de la Ministre de la Communication et de la Culture. Des représentants de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), ainsi qu'une délégation importante du patronat et du secteur privé Malagasy, fait également partie de la délégation.
Le Plan Émergence Madagascar adopté par le Président Rajoelina à Madagascar s'aligne fortement avec les réformes et investissements entrepris par le Rwanda depuis le début du XXIe siècle. L'impact impressionnant de ces actions sur le peuple rwandais est un exemple pour Madagascar. Cette visite officielle dans le pays des Mille Collines vise donc à s'inspirer du développement tangible observé à Kigali.
Demain matin, une rencontre privée entre le Président Andry Rajoelina et le Président Paul Kagamé est prévue au Palais présidentiel de Kigali. Les deux Chefs d’États partagent une vision commune de patriotisme et de panafricanisme, tout en aspirant à l'émergence du continent africain. Dans le renforcement des relations diplomatiques et économiques, cette visite sera marquée par la signature d'une convention de collaboration entre les deux pays, ainsi que d'un accord de partenariat entre les secteurs privés des deux nations.
L'établissement d'un "Business Council Rwanda-Madagascar" est un autre moment clé de cette visite. Cette organisation vise à concrétiser rapidement les partenariats, à stimuler la collaboration entre entreprises, secteurs privés et investisseurs des deux pays.
hn
Barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty : une ONG s’imprègne des difficultés des populations impactées
L’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) Côte d’Ivoire a rencontré les communautés villageoises impactées par le Projet d’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty (PAHSA), situé dans le département de Tiassalé, les 30 et 31 juillet 2023.
L’objectif de cette visite était d’une part d’échanger et de recenser les problèmes liés à l’installation de ce barrage et d’autre part de partager les expériences, renforcer les compétences et favoriser la collaboration entre les membres des différentes communautés.
Ainsi, plusieurs activités ont meublé ces deux journées. Il s’agit notamment d’un dialogue ouvert et constructif entre les différentes communautés impactées par le projet de barrage thermique d’Antikou (Jacqueville) et le barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, des partages d’expériences liés aux impacts du projet et des propositions de solutions aux autorités par les concernés. Sans manquer de dénoncer les impacts négatifs de certains investissements internationaux.
Le secrétaire général de la chefferie de Taboth, Ehui Jérôme, a présenté la situation qui prévaut au sein de sa communauté. « En 2019, nous avons été approchés par les autorités. Elles sont venues inspecter Jacqueville qui est composée de 44 villages avec la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité (CIPREL). Le choix est tombé sur 3 sites du village de Taboth. Ne sachant pas les aboutissements dudit projet, nous avons accepté et ensuite Côte d'Ivoire Energies est arrivée. Nous avons été informés par courriers de la mise en place d'une centrale thermique internationale qui aura une puissance de 400 KW. Il fallait 30 hectares. On leur a proposé la location, ce qui a été refusé et l’achat des parcelles nous a été imposé à 2000 FCFA le m2. Nous avons engagé des discutions pour finalement obtenir le m2 à 3000 FCFA », a-t-il relaté, déplorant la dégradation de la route à cause des travaux de construction du barrage et la situation des populations d’Abreby, un autre village de la région de Jacqueville également impacté.
Le village d'Abreby bénéficie, tout de même, d’un centre de santé, d’une école maternelle et d’un foyer des jeunes. « Ce qui est encore insuffisant », a martelé la présidente des femmes de Abreby, Laurence Beugré.
Le responsable de la justice sociale et des programmes de l’ONG JVE Côte d’Ivoire, Nahounou Daleba, a expliqué la mission et les objectifs de son organisation, avant d’exhorter à l’union. « Si vous êtes bien structurés et organisés, vous obtiendrez gain de cause. Jeunes, femmes, vieux, mettez-vous ensemble et luttez. Nous sommes-là pour vous soutenir dans ce combat que vous avez décidé de mener, afin qu’on vous dédommage à un certain niveau dans le respect de la justice sociale », a-t-il soutenu.
L’ONG JVE Côte d’Ivoire travaille à la protection de l’environnement, à la promotion de l’agroécologie paysanne et à la lutte contre les changements par l’influence des politiques et des actions de terrains dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action 2023-2025.
Une correspondance particulière de Marina Kouakou
Perspectives économiques 2023 : l’Afrique centrale a enregistré la meilleure performance économique
L’Afrique centrale a enregistré une accélération de la croissance en 2022, avec un taux de croissance du PIB réel de 5,0% en 2022, contre 3,4% en 2021. Ce regain de l’activité économique a été porté par les cours favorables des matières premières, surtout dans une région qui compte des exportateurs nets de pétrole brut, de minéraux et autres produits de base. Le taux de croissance de la région est supérieur à celui de la moyenne africaine, estimé à 3,8% en 2022, contre 4,8% en 2021. Il devrait s’établir à 4,9% en 2023 et 4,6% en 2024.
Ces résultats ont été publiés par la Banque africaine de développement, le 31 juillet lors du lancement du rapport annuel sur les Perspectives économiques en Afrique centrale 2023, sous le thème général : « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ».
Avec un taux d’inflation de 6,7% en 2022 contre 3,9% en 2021, l’Afrique centrale a enregistré la meilleure performance par rapport aux autres régions d’Afrique : Afrique du Nord (8,2%), Afrique australe (12,6%), Afrique de l’Ouest (17%) et Afrique de l’Est (28,9%).
De même, la région Afrique centrale affiche la meilleure performance en matière budgétaire, avec notamment le plus faible déficit. La situation des finances publiques de la région s’est améliorée en 2022, même si elle reste déficitaire. Elle laisse apparaître un solde budgétaire global, dons compris, de -0,6% du PIB, en amélioration de 0,4 point de pourcentage par rapport au niveau atteint en 2021. Ce déficit observé malgré l’amélioration des cours des principaux produits exportés par les pays de la région s’explique par l’augmentation des dépenses primaires totales liées aux mesures budgétaires de soutien prises par les gouvernements face à la persistance des effets néfastes de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les prix de l’énergie et des produits alimentaires.
« Globalement, les perspectives économiques de la région Afrique centrale sont favorables pour 2023 et 2024. Ces performances sont les résultantes des réformes structurelles mises en œuvre pour soutenir les secteurs non extractifs et de l’augmentation de la demande extérieure et des cours des principaux produits exportés par les différents pays de la région. » a souligné Hervé Lohoues, économiste régional en chef pour l’Afrique centrale et chef de Division par intérim des économistes pays pour l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est et le Nigeria.
Au niveau intrarégional, la croissance a été portée par la République démocratique du Congo, qui a enregistré une croissance de 8,5%.
Au niveau régional, en 2022, c’est le secteur des services qui constitue la principale composante du PIB nominal avec un poids de 42,1%. Le secteur de l’industrie a représenté une part non négligeable, estimée à 41,4% du PIB nominal en 2022 ; la part de l’agriculture dans la région demeure faible, avec un poids de 16,5% dans le PIB nominal. Seul le secteur de l’industrie a vu sa part dans le PIB augmenter de 39,9% (en 2021) à 41,4% en 2022 ; la part des secteurs de l’agriculture et des services ayant baissé respectivement de 16,6% à 16,5% et 43,4% à 42,1% entre 2021 et 2022.
En termes d’option de politique économique, il est indispensable de juguler très rapidement les pressions inflationnistes et surtout la hausse des prix des denrées alimentaires, mais aussi et surtout des rendre les économies plus résilientes. Pour ce faire, une stratégie de transformation structurelle des économies de la région devrait être mise en œuvre à travers notamment le développement de l’agro-industrie, secteur où l’Afrique centrale a un avantage comparatif.
Serge Nguessan, directeur général de la région Afrique centrale de la Banque, a souligné que l’objectif du rapport est de « fournir aux décideurs et populations des informations et des données utiles pour informer les options et décisions politiques dans la région. Le rapport pourra aussi servir à une meilleure préparation de la COP28 prévue à Dubaï en novembre-décembre 2023 ».
L’Afrique centrale a besoin d’environ 128 milliards de dollars entre 2020 et 2030 pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation et faire face aux effets du changement climatique, soit au moins 11,6 milliards de dollars par an entre 2020 et 2030. Ce montant permettrait de répondre aux besoins en matière de croissance verte et de développement durable. Etant donné le déficit de financement climatique auquel sont confrontés les pays d’Afrique centrale, une augmentation rapide des flux financiers est nécessaire pour répondre aux besoins d’actions climatiques.
L’Afrique centrale dispose d’importantes ressources naturelles, notamment le Bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial après l’Amazonie, pouvant soutenir les besoins en financement vert et climatique. La valeur des ressources du capital naturel de la région est estimée à plus de 700 milliards de dollars. A ce propos, une réévaluation des PIB des pays d’Afrique centrale, en relation avec le capital naturel, pourrait être envisagée. Les pays ont entamé la transition avec la mise en place d’un Programme d’appui au développement de l’économie verte en Afrique centrale, et l’adoption de mesures d’atténuation et d’adaptation définies dans leur Contribution déterminée au niveau national.
Comme recommandations, pour attirer le financement du secteur privé, les pays de l’Afrique centrale devront s’engager à mettre en œuvre des instruments de financement innovants. Les gouvernements de la région devront orienter le financement privé du climat vers les secteurs à risques faibles et ayant les rendements les plus élevés pour attirer les investisseurs. Il faut aussi garantir l’accès aux capitaux, aux PME, notamment celles détenues par des femmes et les jeunes.
Le lancement du rapport a enregistré la participation de hauts responsables et d’officiels des pays et des principales institutions régionales.
ng